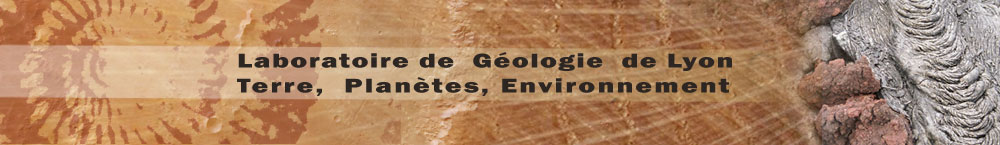Les Stylophores, une énigme paléontologique de 150 ans enfin résolue
L'article a été rédigé par Bertrand LEFEBVRE (Chargé de Recherche au LGL)
Toutes les illustrations sont de MADMEG, une artiste lyonnaise
Le Gisement de Fezouata
Découverts au tout début des années 2000 dans la vallée du Drâa à une vingtaine de kilomètres au Nord de Zagora (Maroc), plusieurs sites de la Formation des Fezouata ont livré des fossiles de l’Ordovicien inférieur (environ 480 millions d’années) qui ont profondément bouleversé les principaux scénarios évolutifs décrivant la diversification initiale des animaux au cours du Paléozoïque inférieur (Van Roy et al. 2010). En effet, la grande majorité des embranchements (phylums) animaux apparaît relativement soudainement –à l’échelle des temps géologiques- au cours de l’Explosion cambrienne (entre environ 541 et 485 m.a.), avant de connaître au cours de l’Ordovicien (485 à 443 m.a.) la plus importante diversification de tout le Phanérozoïque : la Grande Biodiversification ordovicienne. Paradoxalement, les étapes initiales de l’Explosion cambrienne sont particulièrement bien connues, car les roches du Cambrien inférieur à moyen ont livré de très importants gisements dits ‘à préservation exceptionnelle’ (ou Lagerstätten).
Un Lagerstätte ordovicien
En effet, dans ces niveaux sont préservées non seulement les parties minéralisées des organismes (carapaces, coquilles) –les seules habituellement fossilisées- , mais aussi des animaux et/ou des parties de ceux-ci peu ou pas minéralisées. Ces gisements, permettent donc de reconstituer de manière plus fidèle les anciennes communautés animales, mais ils apportent également de précieux renseignements sur l’anatomie de nombreux groupes fossiles, sans équivalents actuels. Jusqu’à la découverte des sites marocains de la région de Zagora, aucun Lagerstätte ordovicien n’avait livré de faunes marines riches et diversifiées, comparables en terme de préservation et d’environnement à celles du Cambrien (Lefebvre et al. 2016). La Grande Diversification ordovicienne n’était donc connue qu’à partir des restes squelettiques (minéralisés) extrêmement abondants découverts dans le monde entier et elle était généralement considérée comme une seconde phase de diversification majeure, bien distincte de l’Explosion cambrienne. Il était généralement admis qu’une grande partie des organismes ‘mous’ ou ‘peu minéralisés’ qui foisonnaient dans les Lagerstätten cambriens avaient disparu à la fin du Cambrien moyen, il y a environ 497 m.a. (Gould 1989).
Les gisements fossilifères de la région de Zagora sont pour l’instant les seuls Lagerstätten au monde à avoir livré des faunes marines à préservation exceptionnelle datant de l’Ordovicien, aussi riches et diversifiées que celles des sites cambriens (Lefebvre et al. 2016). Elles ont donc permis de comparer, pour la première fois, à préservation équivalente, des assemblages caractéristiques de l’Explosion cambrienne avec des faunes typiques de la Grande Biodiversification ordovicienne. Sans grande surprise, la composante minéralisée des assemblages de la Formation des Fezouata est constituée d’organismes caractéristiques de l’Ordovicien, comme par exemple : les bivalves, les céphalopodes orthocônes, les crinoïdes, les étoiles de mer, les graptolites, les ostracodes ou les trilobites. La composante ‘molle’ ou peu minéralisée est formée par contre à la fois d’organismes qui n’étaient connus jusqu’alors que dans des Lagerstätten plus récents (cirripèdes, euryptérides et limules, par exemple), mais aussi et surtout une incroyable diversité de fossiles caractéristiques des Lagerstätten cambriens, comme par exemple : les anomalocaridides, les marrellomorphes, les naraoiides ou encore certaines formes d’éponges très primitives (Van Roy et al. 2010). Leur abondance dans le Lagerstätte des Fezouata témoigne donc de la persistance, au moins jusqu’à l’Ordovicien inférieur, de nombreux groupes que l’on pensait éteints à la fin du Cambrien moyen. Par conséquent, il semblerait désormais que l’Explosion cambrienne et la Grande Biodiversification ordovicienne appartiennent à un seul et même événement de diversification.
Les parties molles, la clé de l'énigme
Au cours de ces dernières années, les gisements à préservation exceptionnelle de la Formation des Fezouata ont permis de résoudre plusieurs énigmes paléontologiques. Ainsi, la découverte de ‘parties molles’ chez des organismes énigmatiques qui n’étaient connus que par leurs restes squelettiques à permis de les replacer dans l’arbre du Vivant, comme par exemple : les machaeridiens (désormais identifiés comme des annélides ‘cuirassés’ ; Vinther et al. 2008) ou encore les halkiériides (ré-interprétés comme des mollusques primitifs ; Vinther et al. 2017). Plus récemment, les Lagerstätten marocains ont livré des fossiles qui permettent de clore près de 150 ans d’un débat acharné portant sur l’interprétation d’un autre groupe particulièrement énigmatique : les stylophores (Lefebvre et al. 2019).
Les Stylophores en question
Les stylophores sont des deutérostomes (super-phylum regroupant les hémichordés, les échinodermes et les chordés –dont les vertébrés-) qui ont vécu dans tous les océans pendant près de 210 millions d’années, du Cambrien moyen au Carbonifère supérieur (de 509 à 299 m.a.). Ce sont des fossiles de petite taille (0,5 à 3 cm environ) dont le corps est constitué de deux parties : un corps (thèque) aplati, massif, asymétrique, qui renfermait la plupart des organes et, inséré dans celui-ci, un appendice articulé, long et étroit (aulacophore). Le corps et l’appendice des stylophores sont constitués de milliers de plaques calcitiques qui présentent les mêmes caractéristiques (minéralogie, microstructure) que les éléments squelettiques des échinodermes (oursins, étoiles de mer). Les stylophores ne montrent par contre aucune trace de la symétrie radiaire, souvent d’ordre cinq, typique de ce phylum (par exemple, les cinq bras d’une étoile de mer).
Une tige, un bras, une queue, tout est possible...
Cette morphologie atypique a été à l’origine d’une controverse particulièrement active quant à la position de ces fossiles au sein des deutérostomes, une grande partie des débats étant centrés sur l’interprétation de l’aulacophore. Pendant un siècle (1860-1960), l’appendice a tout d’abord été interprété comme une tige équivalente à celle des crinoïdes (lys de mer) actuels (Barrande 1887, Jaekel 1901, Chauvel 1941). Dans ce scénario, les stylophores étaient considérés comme des échinodermes ‘normaux’ proches des cystoïdes (un groupe d’échinodermes pédonculés connus uniquement au Paléozoïque). Au début des années 1960, le paléontologue belge Georges Ubaghs a réinterprété l’appendice des stylophores comme étant un bras, comparable en morphologie à un bras unique de crinoïde ou d’étoile de mer (Ubaghs 1961, 1981). Peu après, le paléontologue britannique Richard Jefferies a proposé que les stylophores représentent le ‘chaînon manquant’ entre échinodermes et vertébrés (Jefferies 1968, 1986). Dans cette hypothèse, les stylophores seraient des ‘calcichordés’, dont la morphologie présenterait à la fois des caractéristiques propres aux échinodermes (plaques calcitiques) et aux chordés (pharynx, cerveau, notochorde). L’aulacophore serait alors une queue musculeuse pourvue d’une notochorde. A partir des années 2000, un autre paléontologue britannique, Andrew Smith, a suggéré que les stylophores correspondraient au ‘chaînon manquant’ entre hémichordés et échinodermes (Smith 2005, 2008). Dans ce scénario, l’aulacophore serait une queue comparable à celle de certains hémichordés. Les stylophores présenteraient alors un mélange de caractères propres aux deutérostomes primitifs et aux hémichordés (queue, pharynx) et aux échinodermes (plaques calcitiques). Il en résulte que, depuis une cinquantaine d’années et plus particulièrement au cours des 15 dernières années, les stylophores apparaissent régulièrement dans les études portant sur l’origine et la diversification des deutérostomes au cours du Cambrien. Ils appartiennent donc, aux côtés des cambroernides (Caron et al. 2010), des vétulicoliens (Conway Morris 2003) ou de Pikaia (Conway Morris & Caron 2012), au bestiaire fantastique et mystérieux des deutérostomes primitifs.
La campagne de fouille de 2014
Toutes ces hypothèses reposent uniquement sur l’interprétation de restes squelettiques. Elles ont toutes cependant des implications en terme d’anatomie interne, que la découverte –pour la première fois au monde- de parties molles préservées chez des fossiles de la Formation des Fezouata a permis de tester (Lefebvre et al. 2019). Ces fossiles ont été récoltés durant une campagne de fouilles d’un mois (janvier-février 2014) organisée conjointement par des équipes françaises (notamment l’UMR 5276 LGLTPE de l’Université Lyon 1) et marocaines (FST, Université Cadi-Ayyad de Marrakech) dans le cadre d’un projet financé par l’ANR (projet RALI) et une coopération entre le CNRS (France) et le CNRST (Maroc). Durant ces fouilles, plusieurs niveaux fossilifères ont été exploités autour de la colline de Bou Izargane, à une vingtaine de kilomètres au Nord de Zagora. L’un de ces niveaux a été intégralement fouillé et l’ensemble de la faune prélevé. L’assemblage ainsi récolté a fourni de nombreux échantillons d’arthropodes à préservation exceptionnelle, parmi lesquels des marrellomorphes (formes typiques du Cambrien), mais aussi des trilobites dont les appendices (pattes, antennes) et certains organes (tube digestif) sont conservés (Martin 2016). Ce niveau a également fourni plusieurs centaines d’échantillons de stylophores, dont quelques-uns présentent des parties molles préservées à la fois dans l’appendice, mais aussi à l’intérieur de la thèque (Lefebvre et al. 2019). Ces parties molles n’ont été découvertes qu’une fois le matériel déballé, lors de son examen à la loupe binoculaire, au sein de l’UMR 5276, en mars 2014. Leur identification a par la suite été confirmée par la réalisation fin 2014-début 2015 de cartographies élémentaires au Centre Technologique des Microstructures (CTm) de Lyon 1, qui ont permis de visualiser très distinctement les parties originellement molles, désormais préservées sous forme de pyrite.
L'appendice est donc...
Plusieurs échantillons de stylophores de la Formation des Fezouata montrent très distinctement que leur appendice contenait deux canaux longitudinaux, dont le plus externe portait, latéralement, de fines petites expansions qui sortaient de l’aulacophore et communiquaient donc librement avec le milieu extérieur (Lefebvre et al. 2019). Ces observations sont incompatibles avec les interprétations de l’appendice des stylophores en tant que structure fermée (queue ou tige). Elles montrent au contraire une étonnante similarité avec le système ambulacraire présent dans les bras des échinodermes actuels (crinoïdes, étoiles de mer, par exemple), avec un canal aquifère longitudinal et de part et d’autre de celui-ci, des pieds ambulacraires (podions) en contact permanent avec l’eau de mer. Les parties molles préservées dans l’appendice des fossiles de la Formation des Fezouata permettent donc de rejeter définitivement les hypothèses interprétant ces fossiles comme des échinodermes pourvus d’une tige (Jaekel 1901), des calcichordés (Jefferies 1968) ou encore des échinodermes primitifs proches des hémichordés (Smith 2005). Elles démontrent au contraire qu’il s’agit d’échinodermes pourvus d’un bras unique comparable à celui des crinoïdes ou des étoiles de mer (Ubaghs 1961). Il en résulte que les stylophores sont des échinodermes presque ‘normaux’ : l’absence de symétrie cinq chez ces fossiles est probablement secondaire et pourrait résulter de leur mode de vie libre (non attaché) à plat, sur les fonds marins (Lefebvre et al. 2019).
Références
- Barrande, J., 1887. Système Silurien du centre de la Bohême. Volume VII. Classe des Echinodermes, Ordre des Cystidées. Rivnàc, Prague, Gerhard, Leipzig,
- Caron,J.B., Conway Morris, S., Shu, D.G., 2010. Tentaculate fossils from the Cambrian of Canada (British Columbia) and China (Yunnan) interpreted as primitive deuterostomes. PlosOne 5, e9586.
- Chauvel, J., 1941. Recherches sur les cystoïdes et les carpoïdes armoricains. Mémoires de la Société géologique et minéralogique de Bretagne 5, 1–286.
- Conway Morris, S., 2003. The Cambrian "explosion" of metazoans and molecular biology: would Darwin be satisfied? International Journal of Developmental Biology 47, 505–515.
- Conway Morris, S., Caron, J.B., 2012. Pikaia gracilens Walcott, a stem-group chordate from the Middle Cambrian of British Columbia. Biological Reviews 87, 480–512.
- Gould, S.J., 1989. Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History. Norton, New York.
- Jaekel, O., 1901. Uber Carpoideen; eine neue Klasse von Pelmatozoen. Zeitschrift der deutschen geologischen Gesellschaft 52, 661–677.
- Jefferies, R.P.S., 1968. The subphylum Calcichordata (Jefferies 1967) primitive fossil chordates with echinoderm affinities. Bulletin of the British Museum (Natural History), Geology 16, 243–339.
- Jefferies,R.P.S., 1986.The Ancestry of the Vertebrates. British Museum (Natural History), London.
- Lefebvre, B., El Hariri, K., Lerosey-Aubril, R., Servais, T., Van Roy, P., 2016. The Fezouata Shale (Lower Ordovician, Anti-Atlas, Morocco): a historical review. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology 460, 7–23.
- Lefebvre, B., Guensburg, T.E., Martin, E.L.O., Mooi, R., Nardin, E., Nohejlova, M., Saleh, F., Kouraïss, K., El Hariri, K., David, B., 2019. Exceptionally preserved soft parts in fossils from the Lower Ordovician of Morocco clarify stylophoran affinities within basal deuterostomes. Geobios 52, 27–36.
- Martin, E.L.O., 2016. Communautés animales du début de l’Ordovicien (env. 480 Ma): études qualitatives et quantitatives à partir des sites à préservation exceptionnelle des Fezouata, Maroc. Thèse de doctorat (non publiée), Université Lyon 1, Villeurbanne.
- Smith, A.B., 2005. The pre-radial history of echinoderms. Geological Journal 40, 255–280.
- Smith, A.B., 2008.Deuterostomes in a twist: the origins of a radical new body plan. Evolution & Development 10, 493–503.
- Ubaghs, G., 1961. Sur la nature de l’organe appelé tige ou pédoncule chez les “carpoïdes” Cornuta et Mitrata. Comptes-Rendus de l'Académie des Sciences, Paris 253, 2738–2740.
- Ubaghs, G. 1981. Réflexions sur la nature et la fonction de l’appendice articulé des “carpoïdes” Stylophora (Echinodermata). Annales de Paléontologie 67, 33–48.
- Van Roy, P., Orr, P.J., Botting, J.P., Muir, L.A., Vinther, J., Lefebvre, B., El Hariri, K., Briggs, D.E.G., 2010. Ordovician faunas of Burgess Shale type. Nature 465, 215–218.
- Vinther, J., Van Roy, P., Briggs, D.E.G., 2008. Machaeridians are Palaeozoic armoured annelids. Nature 451, 185–188.
- Vinther, J., Parry, L., Briggs, D.E.G., Van Roy, P., 2017. Ancestral morphology of crown-group molluscs revealed by a new Ordovician stem aculiferan. Nature 542, 471–475.